|
Marie-Françoise Dubois-Sacrispeyre : Constatant que certaines librairies ont enfin ouvert un espace « Travail social », nous avons eu envie de leur donner raison et de mettre en avant nos parutions qui relèvent de ce secteur. Ainsi à l’automne, avec l’aide de nos auteurs et celle de notre diffuseur Le Seuil, nous souhaitons faire parler du travail social, de ses métiers, de ses acteurs, de ses réussites, de ses impasses, bref du fourmillement d’idées et de pratiques qui animent ce secteur.
Peux-tu nous dire quels ont été ton itinéraire et l’origine de ton engagement d’éducateur ? Quelles ont été tes références, tes « maîtres à penser » ? L’écriture a-t-elle toujours été pour toi une nécessité ? Que cherches-tu à transmettre dans tes livres ? Philippe Gaberan : L’itinéraire est une vraie question philosophique dans le sens où, paradoxalement, il me semble que rien de ce qui m’est arrivé jusqu’ici dans la vie n’est arrivé par hasard, et où cependant rien n’était pour autant écrit par avance. Il n’y a aucune fatalité dans ce qui arrive à chacun mais, pour autant, chacun n’est pas absolument libre de son devenir. Il me semble qu’une trajectoire de vie se compose d’un ensemble d’opportunités, lesquelles sont pour la plupart des rencontres humaines ; il appartient à chacun de savoir s’en saisir. La plus grande difficulté consiste alors à ne pas passer à côté de ceux qui fondamentalement peuvent vous aider à grandir. Ces personnes-là sont mes références dans le sens où elles sont pour moi des maîtres à vivre ou des maîtres à penser ; ce sont des éducateurs ou des mentors, comme j’ai pu l’écrire à plusieurs reprises, notamment dans l’ouvrage collectif sur la Métaphore de l’éducateur (sous la dir. de Jean Brichaux, érès, 2004).De fait, dans mon itinéraire, la première rencontre, celle qui sans aucun doute est fondatrice de mon existence, est la rencontre avec mon père et ma mère.Celle-ci n’a pas eu lieu à la naissance ! Mon père, d’ailleurs, le jour de ma venue au monde, était en Algérie, engagé dans une guerre qui ne disait pas encore son nom. La véritable rencontre avec mes parents s’est faite au terme d’un travail psychothérapeutique qui me permet aujourd’hui de poursuivre plus sereinement mon chemin de vie. La seconde rencontre marquante a été avec un couple d’éducateurs, Jean-Paul et Brigitte. J’avais vingt ans et ils m’ont véritablement transmis la passion d’un métier à une époque où j’étais surtout un « écorché vif ». La troisième formidable rencontre est celle avec la philosophie et un ensemble de figures gravitant autour de l’université Jean Moulin à Lyon. Ce furent des auteurs (Aristote, Marc-Aurèle, Pascal, Condillac, puis Deleuze, Derrida, Foucault ; je passais des nuits à lire leurs textes sans rien y comprendre) et ce furent des professeurs aussi ; François Dagognet avec qui j’ai eu des disputes, des vraies, faites d’échanges d’arguments poussés à la limite de l’engueulade, ou Pierre Cariou avec lequel j’ai eu des moments de partage intense. Il fut un philosophe professeur comme il en existe peu. Si j’avance dans le temps, l’autre immense rencontre est celle avec Fabienne, devenue ma femme. Là encore rien d’immédiat dans cette histoire d’amour sans laquelle je ne serais rien de ce que je suis aujourd’hui ; parce que, elle, Fabienne, savait bien avant moi qui j’étais. Et puis, il y a la rencontre avec André Jonis, à l’époque directeur du journal Lien social. Il est celui qui m’a appris à tailler ma plume sans rien rogner de sa force (voir Passeurs d’humanité, à paraître chez érès). Quant à l’équipe de Lien social, pilotée aujourd’hui par Jean-Luc Martinet, elle a été durant vingt ans le maître d’oeuvre de grands rendez-vous du travail social sur Toulouse et l’occasion de côtoyer François Tosquelles ainsi que Lucien Bonnafé, bien sûr, et aussi des personnalités trop vite disparues comme Jean Noël Chopart ou Christian Bachman… Jusqu’à la rencontre enfin avec érès qui, elle aussi, est une histoire qu’il a fallu saisir. En effet, mes premiers ouvrages publiés ne figurent pas au catalogue de cette belle maison ; en revanche, c’est l’estime et l’amitié qui font que je suis là aujourd’hui. Quant à l’écriture, elle n’est pas venue de suite ; au tout début de mon itinéraire, il y a la lecture. Des heures d’enfance puis d’adolescence passées à lire.A lire tout. Je ne faisais aucun tri. L’écriture naît là, dans la lecture. Et à mon tour, à travers mes livres, comme les premiers hommes à travers leurs traces peintes sur les parois des cavernes, je ne transmets rien d’autre que le désir et la nécessité de transmettre. Ce qui se transmet dans l’écriture c’est l’acte de transmettre. La supériorité de l’humain, ce qui fait qu’il l’emporte sur la bestialité, c’est la transmission.Un acte banal et pourtant essentiel parce que vital à l’heure des OGM, du clonage, du formatage culturel et des civilisations sans héritage. |
|
MFDS : Comme tu me le disais dans un courrier récent, tu penses que l’avenir des métiers du social passe par « le savoir-dire ce que les professionnels savent faire ». Cela m’a fait plaisir car c’est l’un de mes objectifs d’éditeur, qui a trouvé notamment à s’exprimer dans la collection « L’éducation spécialisée au quotidien » dès 1995, mais aussi dans d’autres ouvrages parus antérieurement ou dans d’autres collections. Depuis 2002, sous la direction de Bernadette Allain- Launay et Serge Vallon, la collection « Trames » apporte sa contribution à l’identification des différents métiers du social, à la connaissance des publics et des institutions concernés, à l’interrogation des outils et médiations à la disposition des travailleurs sociaux. Comment, dans tes fonctions de formateur, incites-tu les étudiants à écrire sur leur pratique ? Quels effets peux-tu constater ? PG : Amener l’élève à l’écriture est un acte pédagogique complexe qui ne relève pas seulement de la transmission de quelques techniques ou méthodes. Certes, cette démarche-là est nécessaire mais elle n’est pas suffisante. Pour que l’élève écrive, il faut d’abord qu’il se sente autorisé à le faire ! Et ici l’autorisation n’est pas seulement une permission accordée par un autre ayant pouvoir de le faire ; l’autorisation est une réelle délégation d’autorité, laquelle ouvre le droit à être « auteur » de la chose écrite : l’élève doit avoir la conviction que ce qu’il dit ou écrit est digne d’intérêt, est susceptible d’intéresser un autre que lui-même. Et cette autorisation, sa reconnaissance en qualité d’auteur, il la puise dans le regard du maître.C’est une leçon que j’ai apprise de mon maître et ami Philippe Meirieu. Voilà un homme qui a été insulté à la Une du journal Le Monde et dans d’autres médias et qui pourtant est l’un des rares professeurs à citer et à remercier ses étudiants, souvent des thésards, dans ses propres ouvrages. C’est la force des grands pédagogues, tels que Célestin Freinet, ou encore Paolo Freire, dont érès a publié une très belle traduction de La pédagogie de l’autonomie, que de savoir rendre leurs élèves fiers de ce qu’ils écrivent. Pour inciter à l’écrit, il faut faire un détour par le regard et passer par « l’encre de tes yeux » que chante Francis Cabrel. Il est sans doute dommage que les élans de bonheur en lien avec les premiers écrits de l’enfance succombent trop vite aux premières paroles méprisantes des adultes et aux notes cinglantes des petits maîtres. Au commencement, l’enfant est heureux d’apprendre et d’écrire ; c’est seulement après que ce rapport se modifie et que l’envie et la curiosité s’estompent. J’avoue avoir la chance de travailler avec des collègues formateurs pour qui la pédagogie de la réussite est un élément moteur de la relation d’apprentissage ; cela crée une atmosphère qui inspire les apprenants et leurs écrits.Car l’éducateur est souvent convaincu que ce qu’il écrit est « nul à chier » ou « banal à pleurer » alors que les petits actes du quotidien qu’il transcrit dans ses travaux d’étude, dans ses notes de synthèse ou ses rapports au juge, sont l’essence même du grandir. Lacer un soulier, prendre un enfant par la main, choisir un vêtement ou souligner d’un crayon noir les yeux d’une adolescente sont des événements tus grâce auxquels pourtant surgit cette confiance tant convoitée et souvent décrite comme survenant de nulle part. Aussi, pour transmettre aux étudiants l’envie et le plaisir d’écrire, faut-il les amener à l’amour d’euxmêmes. L’écrit est d’abord un cri qui surgit de l’intérieur, qui part du ventre et non de la tête. Une telle démarche nécessite donc de l’engagement dans l’accompagnement. Le formateur n’est pas seulement un guide méthodologique ou un correcteur. Et l’enjeu est ici de taille puisqu’il s’agit de démocratiser l’écrit sans le vulgariser. Si désormais tout le monde peut avoir son quart d’heure de gloire à la télévision, selon la célèbre prédiction de McLuhan, tout le monde ne peut pas devenir auteur et encore moins écrivain. Il y a comme une insulte au travail et à l’art de l’écriture que de faire croire à de telles fadaises. Le savoir-écrire se travaille et se travaille d’autant plus que l’écrit est désormais devenu une compétence professionnelle majeure de l’éducateur. |
|
MFDS : Je suis avec attention tes rubriques dans Lien social : elles sont toujours, à l’occasion d’un événement national ou local, l’occasion d’éclairer l’évolution du secteur, la professionnalisation des métiers, ou plus globalement du regard que la société porte sur les plus démunis. Comment selon toi se porte le travail social ? Dans quelles directions te semble-t-il se diriger ? De tout temps il a été pris en otage entre les injonctions de la paix sociale et la réparation des injustices de la vie.Quel espace crois-tu possible de déployer entre les deux ?
Ce capitalisme n’est pas seulement un modèle d’organisation économique mais il est fondamentalement une philosophie dont le paradigme est la destruction de l’humain. Il faut lire La fin de l’homme de Francis Fukuyama – qui fut un temps le chantre de ce néolibéralisme – pour comprendre ce qui est à l’oeuvre dans cette volonté d’éradiquer toute présence humaine au sein des institutions. Pour le capitalisme néolibéral dont les valeurs cardinales sont l’efficacité et la rentabilité, l’humain est synonyme de « facteur à risque » ; et donc une composante à éliminer. Car l’humain, c’est l’imprévisibilité et c’est l’unicité, autant de qualités que la machine capitaliste, pour reprendre les termes de Gilles Deleuze et Félix Guattari, va s’employer à subsumer par la planification des ressources, la modélisation des procédures et la conformation des travailleurs. Les sociétés modernes assistent à la montée d’une forme nouvelle du totalitarisme, plus soft parce que politiquement plus correct, mais tout aussi destructeur de ce qui fait l’humain de l’homme. Le drame vient de ce que le travail social se laisse gagner par cette gangrène ; ne serait-ce que parce que la plupart de ses dirigeants ou de ses représentants aux plus hautes instances se laissent eux aussi gagner par l’illusion de la gestion, de l’ordre, d’une qualité fondée sur le bon fonctionnement des structures et non sur le bien-être des personnes accueillies. Mais je reste radicalement optimiste, faisant mienne cette morale de Jean de Lafontaine : « Tous étaient malades mais tous n’en mourraient pas. » Phrase qui est aussi un clin d’oeil à La Peste de Albert Camus. Quand tu dis que l’éducateur est pris en otage entre les injonctions de la paix sociale et la réparation des puissent continuer à être pleinement dans leur existence et pas seulement à gagner laborieusement leur survie. Le second pilier de l’entreprise érès est sa dimension familiale et sa taille humaine. D’aucuns voient là le symptôme d’un archaïsme car, depuis plus de vingt ans, il nous est rabâché qu’il faut être « gros » pour gagner des parts de marché. Pour ma part, il y a belle lurette, et je l’ai maintes fois écrit, que je vois dans la taille humaine d’une entreprise ou d’une institution une preuve de bon sens et un signe d’avenir. Si avec une petite minorité de personnes nous nous sommes longtemps sentis isolés dans nos convictions, trop souvent raillés voire méprisés à travers celles-ci, quelques analyses récentes, notamment sur la taille des universités ou des entreprises allemandes (le modèle capitaliste rhénan), viennent inverser la tendance et soutenir nos positions. Erès est et reste une entreprise moderne dont la vocation doit être d’attirer à elle de véritables auteurs. Sur ce plan-là tu as raison de dire qu’il y a de la créativité dans le secteur. De fait, si de repérer les auteurs est bel et bien une tâche aussi essentielle que capitale, l’autre tâche tout aussi vitale est d’amener les travailleurs sociaux à s’intéresser à leurs propres écrits. Le point faible des travailleurs sociaux vient de ce qu’ils sont, aujourd’hui encore, convaincus que la science de leur savoir-faire réside ailleurs que dans leur propre savoir-dire. En clair, ils vont vainement chercher dans d’autres disciplines scientifiques ce qu’ils ont d’abord à produire eux-mêmes. La chaire en travail social au CNAM, occupée par Brigitte Bouquet, l’existence de collections authentifiées « travail social » chez érès, la survivance contre vents et marées d’un journal comme Lien social, journal, faut-il le rappeler, fait par et pour des travailleurs sociaux, sont autant de vecteurs qui permettent effectivement de rêver l’avenir du travail social et donc, je le maintiens en dépit de l’illusion d’orgueil qu’une telle association pourrait produire, la survie de l’humanité. Etre éducateur aujourd’hui, c’est croire avant tout au devenir de l’espèce…, l’agir et l’écrire. injustices de la vie, je soulignerais pour ma part qu’il est un veilleur de l’humain et que sa mission est de se tenir aux limites de l’espace social. Pour Stanislas Tomkiewicz, l’éducateur est un pont tendu entre deux berges et il n’est ni d’un monde ni d’un autre ; il est entre les deux. Il y a peu encore les personnes handicapées étaient cachées ou honteusement éloignées du domicile familial ; des parents et des professionnels se sont élevés contre cette fatalité. Et si le pari d’une intégration sociale est loin d’être gagné, il est malgré tout en bonne voie. Le devoir de l’éducateur – il faut entendre ici le terme de « devoir » dans sa dimension éthique – est de contribuer sans cesse à l’élargissement de l’espace social, d’ouvrir ainsi les possibles. C’est par ce biais-là qu’il oeuvre à l’avènement des droits de l’homme. Rien de facile dans cette tâche ! |
|
MFDS : Si on regarde les choses de haut, globalement, on peut être tenté de se décourager. Pourtant mon sentiment, à la lecture des manuscrits que je reçois, est que nombreux sont les travailleurs sociaux qui, dans leur expérience singulière, se débrouillent avec les paradoxes de leurs fonctions et imaginent des dispositifs innovants à forte valeur humaine ajoutée. Crois-tu que ce sont des exceptions qui s’adressent aux éditions érès, ou sont-ils emblématiques de la créativité de tout un secteur ? PG : Il est indéniable qu’il y a une exception érès ; une exception d’ailleurs que j’ai appris à goûter et dont, en qualité d’auteur, je ne pourrais plus me passer. Cette exception s’appuie sur deux piliers. Le premier est le champ ciblé par les éditions qui est celui des sciences humaines avec – et c’est une constante entre tous les ouvrages que j’ai pu lire chez érès – un parti pris humaniste clairement affirmé. L’idéalisme, la religion, le nihilisme et aujourd’hui le capitalisme néolibéral sont autant de philosophies ou de croyances successives qui, au cours de l’histoire et à des époques différentes, ont eu pour objectif de détruire l’humanisme ; c’est-à-dire de détruire la part d’humanité qu’il y a dans l’homme. L’intérêt de l’immense production des éditions érès est de questionner, collection par collection, livre par livre, revue par revue, page par page et phrase par phrase, ce qui fait l’humain de l’homme. Il demeure tellement d’évidences à déconstruire et à reconstruire pour faire en sorte que les générations futures puissent continuer à être pleinement dans leur existence et pas seulement à gagner laborieusement leur survie. Le second pilier de l’entreprise érès est sa dimension familiale et sa taille humaine. D’aucuns voient là le symptôme d’un archaïsme car, depuis plus de vingt ans, il nous est rabâché qu’il faut être « gros » pour gagner des parts de marché. Pour ma part, il y a belle lurette, et je l’ai maintes fois écrit, que je vois dans la taille humaine d’une entreprise ou d’une institution une preuve de bon sens et un signe d’avenir. Si avec une petite minorité de personnes nous nous sommes longtemps sentis isolés dans nos convictions, trop souvent raillés voire méprisés à travers celles-ci, quelques analyses récentes, notamment sur la taille des universités ou des entreprises allemandes (le modèle capitaliste rhénan), viennent inverser la tendance et soutenir nos positions. Erès est et reste une entreprise moderne dont la vocation doit être d’attirer à elle de véritables auteurs. Sur ce plan-là tu as raison de dire qu’il y a de la créativité dans le secteur. De fait, si de repérer les auteurs est bel et bien une tâche aussi essentielle que capitale, l’autre tâche tout aussi vitale est d’amener les travailleurs sociaux à s’intéresser à leurs propres écrits. Le point faible des travailleurs sociaux vient de ce qu’ils sont, aujourd’hui encore, convaincus que la science de leur savoir-faire réside ailleurs que dans leur propre savoir-dire. En clair, ils vont vainement chercher dans d’autres disciplines scientifiques ce qu’ils ont d’abord à produire eux-mêmes. La chaire en travail social au CNAM, occupée par Brigitte Bouquet, l’existence de collections authentifiées « travail social » chez érès, la survivance contre vents et marées d’un journal comme Lien social, journal, faut-il le rappeler, fait par et pour des travailleurs sociaux, sont autant de vecteurs qui permettent effectivement de rêver l’avenir du travail social et donc, je le maintiens en dépit de l’illusion d’orgueil qu’une telle association pourrait produire, la survie de l’humanité. Etre éducateur aujourd’hui, c’est croire avant tout au devenir de l’espèce…, l’agir et l’écrire. |
À propos
Retrouvez chaque mois le texte de l'un de nos auteurs sur des sujets d'actualités




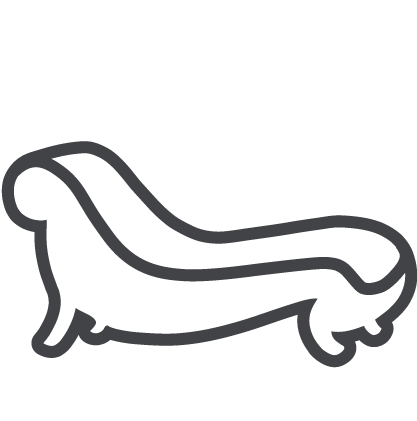
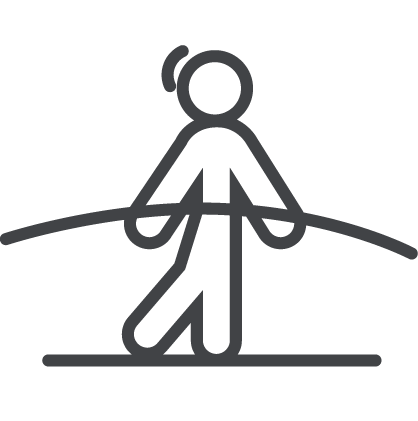
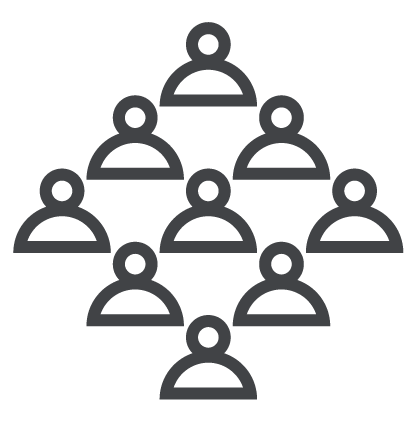









 Il m’a donc semblé évident d’ouvrir cette nouvelle lettre avec toi, Philippe, avec qui nous travaillons depuis longtemps maintenant. En effet, éducateur spécialisé, docteur en sciences de l’éducation, tu es formateur et chercheur en travail social à l’ADEA (Bourg-en-Bresse) mais aussi rédacteur au journal Lien social, auteur de plusieurs ouvrages et articles de référence. De l’engagement en éducation, notre premier projet commun, remonte à 1998 : comme tu le disais à l’époque, « si cet ouvrage est le résultat d’une thèse de troisième cycle, il est aussi l’expression d’un acteur engagé depuis vingt ans dans le travail social. C’est pourquoi la philosophie des Lumières y côtoie la réflexion sur l’acte éducatif. Et l’exercice tiendrait du grand écart si le lecteur n’était pas promptement invité à laisser de côté Émile, l’enfant imaginé par Rousseau, pour s’attacher à l’enfant réel. Dès lors, l’engagement en éducation naît de la nécessité de tenir une promesse : faire de chaque enfant un homme, en dépit des différences. »
Il m’a donc semblé évident d’ouvrir cette nouvelle lettre avec toi, Philippe, avec qui nous travaillons depuis longtemps maintenant. En effet, éducateur spécialisé, docteur en sciences de l’éducation, tu es formateur et chercheur en travail social à l’ADEA (Bourg-en-Bresse) mais aussi rédacteur au journal Lien social, auteur de plusieurs ouvrages et articles de référence. De l’engagement en éducation, notre premier projet commun, remonte à 1998 : comme tu le disais à l’époque, « si cet ouvrage est le résultat d’une thèse de troisième cycle, il est aussi l’expression d’un acteur engagé depuis vingt ans dans le travail social. C’est pourquoi la philosophie des Lumières y côtoie la réflexion sur l’acte éducatif. Et l’exercice tiendrait du grand écart si le lecteur n’était pas promptement invité à laisser de côté Émile, l’enfant imaginé par Rousseau, pour s’attacher à l’enfant réel. Dès lors, l’engagement en éducation naît de la nécessité de tenir une promesse : faire de chaque enfant un homme, en dépit des différences. »








