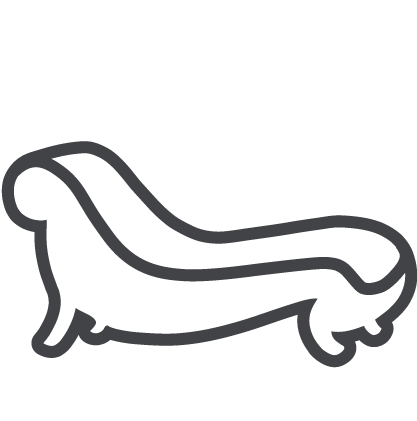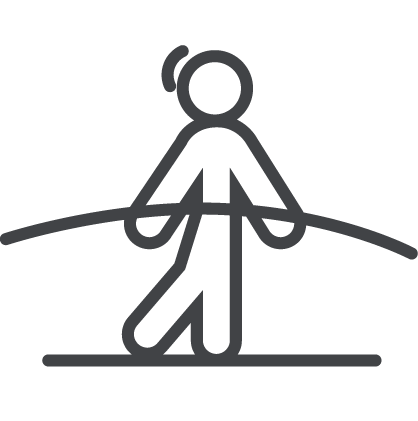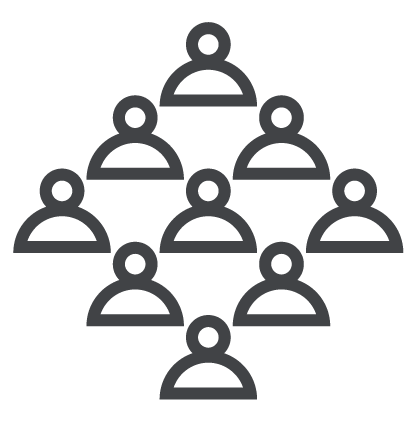Michèle Benhaïm (par Audrey Minart)
 Psychanalyste et professeur de psychopathologie clinique à l'université d'Aix-Marseille (AMU), Michèle Benhaïm a publié en 2016 Les passions vides. Chutes et dérives adolescentes contemporaines en 2016, et remporté le Prix Œdipe des libraires (http://www.oedipe.org/prixoedipe/2017). Dans cet ouvrage, elle se penche sur les problématiques des adolescents en situation de grande détresse (addiction, errance, en prise avec la justice…), et nous démontre en quoi ces difficultés découlent d’une « mauvaise construction de l’altérité ».
Psychanalyste et professeur de psychopathologie clinique à l'université d'Aix-Marseille (AMU), Michèle Benhaïm a publié en 2016 Les passions vides. Chutes et dérives adolescentes contemporaines en 2016, et remporté le Prix Œdipe des libraires (http://www.oedipe.org/prixoedipe/2017). Dans cet ouvrage, elle se penche sur les problématiques des adolescents en situation de grande détresse (addiction, errance, en prise avec la justice…), et nous démontre en quoi ces difficultés découlent d’une « mauvaise construction de l’altérité ».
Propos recueillis par Audrey Minart
Avril 2017.
Qu’entendez-vous par « passions vides », termes rarement réunis ?
« Passions », parce que je fais l’hypothèse que, derrière les symptômes très contemporains que je décris, il reste une sorte d’indestructibilité du désir. « Vide » parce que je traite ici de cliniques extrêmes qui en témoignent. Il s’agit d’un vide altéritaire, de la pensée, de la demande… De l’impossibilité, pour le sujet, de transcrire ses points d’horreur et traces traumatiques, qui restent donc pétrifiées. Au final, cela donne des sujets qui se comportent comme si rien ne pouvait leur arriver, dans une forme d’errance subjective. Le vide, c’est aussi ce qui tourne en rond, ce qui ne s’inscrit pas, ne fait pas expérience, ne s’historicise pas. C’est-à-dire, pour les adolescents dont je parle, qu’ils n’ont rien à perdre. Au sens propre. Ce vide est à l’origine de passages à l’acte qui n’ont cependant pas de fonction d’agir… Ce ne sont que des répétitions, des ritournelles répétitives.
Quelles peuvent être ces traces traumatiques ? Qu’est-ce qui amène à ce vide ? Qu’est-ce qui, quelque part, n’a pas fonctionné ?
C’est pour répondre à cette question que le livre commence, non pas par l’adolescence, mais par quelque chose qui se produit bien en amont. J’évoque ce qu’est un sujet aujourd’hui, le transfert, le temps, m’arrête sur la clinique des bébés, des mères en détresse, des enfants avec ces nouveaux symptômes que l’on voit apparaître, et enfin j’arrive à celle des adolescents. Ceux-ci sont un peu le projecteur de ce que j’essaie de décrire, parce qu’il y a quelque chose de paroxystique à l’adolescence. Et donc ce vide vient essentiellement d’une mauvaise construction de l’altérité. Il n’y a pas de sujet sans Autre. Et donc s’il y a un problème du côté de l’Autre, il y en a un du côté de la construction du sujet. C’est comme si l’adolescent n’avait pas d’Autre auquel s’arrimer et se retrouvait donc dans une espèce de chute éternelle dans le vide... Je précise quand même que ma clinique renvoie à des adolescents en extrêmes difficultés, en proie à des addictions, placés, errants, ou en prise avec la justice… Ils sont très en détresse, très fragiles.
L’altérité se construit avec les parents… Dans les cas que vous rencontrez, on peut donc supposer que c’est à ce niveau-là que quelque chose s’est, ou ne s’est pas, produit ?
Pour contenir un enfant, encore faut-il avoir été contenu. L’occasion de faire un petit clin d’œil à Winnicott avec le concept de « détresse maternelle primaire » : il y a quelque chose là, du côté du maternel, qui ne peut pas être à l’œuvre… Qui, lui-même, n’est pas contenu. On retombe ensuite en cascade sur la solitude, l’isolement, les pères qui, même quand ils sont présents, sont absents… Et avec, en face, un contexte que j’appelle « contemporain ». Il y a toujours eu des pères absents… Alors pourquoi ces effets-là aujourd’hui ? En général, le social pallie ces formes de détresse. Mais aujourd’hui, il ne fait plus non plus fonction d’Autre. A la fois pour les adolescents eux-mêmes, qui se retrouvent souvent en établissement dans des conditions inadéquates et insuffisantes, mais aussi du côté de la famille et de leur entourage proche. Il n’existe plus d’institutions à travers lesquelles les enfants et adolescents circulent, qui peuvent figurer quelque chose de l’Autre, un peu solide et repérant. De là découle la « désubjectivation ». Parce que pour qu’il y ait un socle de construction du sujet, il faut qu’il y ait un psychisme établi avec des points de repères, de sécurité, un sens de la réalité… Tout ce que peut donner un environnement suffisamment contenant. Et là, ce n’est pas le cas.
Vous écrivez : « Il est interdit de penser ». N’est-ce pas cela qui oriente vers l’acte, faute de pouvoir penser ?
Oui. C’est là que l’on retrouve le concept de « contemporain ». Cela s’inscrit dans quelque chose de beaucoup plus large, et a avoir avec la question du soin et de la subjectivité en général. Actuellement, la réponse sociale est très largement comportementale. Or, un adolescent, ce n’est pas une somme de comportements. C’est un sujet en construction. Et donc fragile. Mais dans les structures qui les accueillent, où ils arrivent dans un état psychique d’épuisement, de fragilité, de détresse, ce qu’on leur demande c’est de faire un projet très rapidement. Parce que dans six mois, ils sortent. On omet alors la temporalité subjective. On ne leur laisse pas le temps de se reposer. On ne se laisse pas la possibilité d’entendre, derrière ses manifestations dérangeantes, la véritable souffrance… Nous n’avons plus, dans les institutions, les moyens de travailler avec ce qui fait défaut : le sujet, le temps, l’Autre, le transfert… La société actuelle est dans l’urgence, et ne raisonne qu’à travers le comportement. C’est la rencontre entre ce contemporain et ces parcours de vie, déjà à l’origine complexes, qui font que l’on aboutit autant à des explosions et des détresses incommensurables…
Vous dites aussi que les adolescents aujourd’hui ne parlent pas, qu’ils « communiquent ». Quelle différence ?
La communication entre justement dans le champ du comportement. Tout est fait pour ça : médias, réseaux… Les adolescents communiquent donc en permanence. Pour autant, ils ne parlent pas. Au sens d’habiter ce qui nous constitue comme sujets humains. La communication n’est pas le langage. Il n’y a pas d’engagement subjectif authentique. Ce qui fait de la parole quelque chose d’intéressant c’est qu’elle transforme, contrairement à la communication qui laisse le sujet à la même place, où il ne se passe rien. On rencontre encore, là, la question du vide. On peut se parler pendant cinq heures, et ne rien se dire. On peut ne pas engager notre désir dans le fait de s’adresser l’un à l’autre.
J’imagine que c’est ce à quoi vous êtes, vous, confrontée dans votre clinique : cette difficulté à parler ?
Oui. Au départ, les adolescents sont plutôt méfiants. C’est normal, ils ont été trahis par cinquante adultes depuis qu’ils sont nés. Et donc, quand ils rencontrent le psy, il n’y a aucune raison qu’il se passe autre chose... Il faut construire quelque chose dans le temps pour en arriver à une relation transférentielle, pour poser des repères très classiques avec lesquels on va travailler, pour les sécuriser. Mais ce temps, faut-il encore l’avoir. Et quand c’est le cas, les adolescents s’en saisissent ! Ils parlent. Et souvent, disent qu’ils veulent que quelque chose bouge. Mais pour ce faire, il faut du temps, et se déplacer. Je ne les attends pas dans un bureau, je vais à leur rencontre, leur dire que j’ai envie d’être là, dans cette présence qui est un acte. Je leur dis que nous pouvons peut-être discuter, philosopher un peu. Avec des enfants on joue, avec des ados, on philosophe. Et là, on utilise ce que l’on a à notre disposition : des objets, des intérêts, la musique, etc. Ils sont généralement preneurs... Mais pour cela, il faut considérablement adapter le dispositif qui est le nôtre.