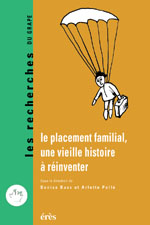
Le placement familial, une vieille histoire à réinventer
Avec la participation de Mohand CHABANE, Joël CHALUBERT, Brigitte COUREE, Henri DE CAEVEL, Martine DUBOC, Michel DUGNAT, Monique GAAS, Françoise GOUSSET, Thérèse GUEGUEN, Véronique HACK, Marylise LE DELLETER, Éveline LE SAUCE, Anne-Marie MARTINEZ, Henri MIALOCQ, Pascale MIGNON-MOREAU, Janine OXLEY, Catherine PENIGAUD, Françoise PETITOT, Michelle ROUYER, Bernard RUHAUD, Anne-France TAPON
On a recours au placement familial le plus tard possible quand on a tout essayé : travailleuse familiale, AEMO, PMI, centre maternel, thérapie… Il est vécu comme un rapt, comme une sanction par les parents, comme un échec par les intervenants sociaux. Qui peut dire comment il est vécu par l'enfant ? La justice tranche au lieu même où les intervenants sociaux délèguent à l'Autre de la Loi la responsabilité du choix. N'apparaît-il pas alors comme la réalisation d'une menace ? A l'enfant " on donne une famille, mais lui donne-t-on ce dont il a besoin pour se construire ? Notre intérêt " pour " l'enfant s'opposerait-il à " l'intérêt de l'enfant " ?
Le cadre juridique et institutionnel du placement familial est pratiquement unique pour tous les types de placements (de longue ou de courte durée, judiciaire ou administratif, pour petits ou pour adolescents, malades ou non). Quelles incidences cela a-t-il ? Neuf ans après la loi de 1992 qui marque la professionnalisation des assistant(e)s maternel(le)s et la reconnaissance de la dimension thérapeutique de cet accompagnement, quelle analyse, quelle critique, quels enseignements, permettent de repenser les pratiques qui doivent aujourd'hui s'inventer pour répondre de façon diversifiée à des situations familiales de plus en plus complexes et à l'accueil d'enfants en très grande souffrance ?
Papier - 0.00 €
PDF - 15.99 €
EPub - 15.99 €
Détails
Parution : 27 août 2002
EAN : 9782749200705
16x24, 168 pages
Les recherches du grape
Thème : Enfance & parentalité