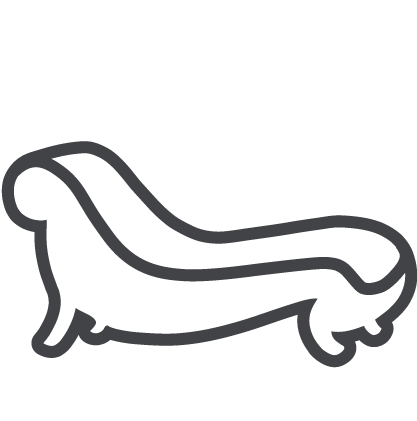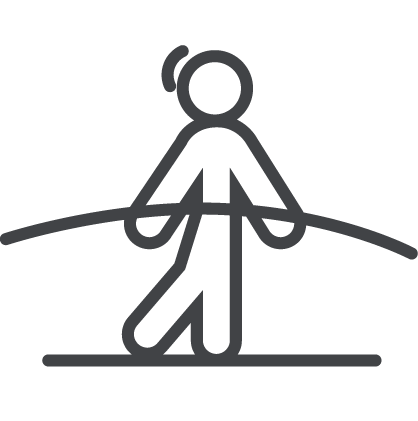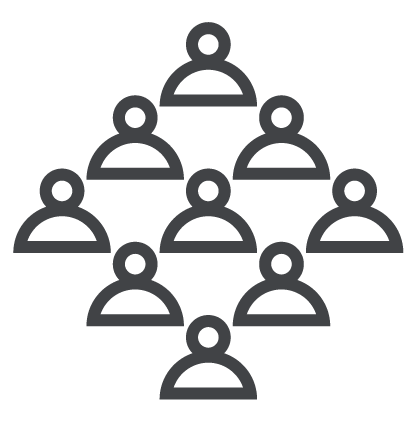Agnès Vandevelde-Rougale (par Audrey Minart)
 Socio-anthropologue et chercheuse associée au Laboratoire de changement social et politique (université Paris-Diderot-Paris 7), Agnès Vandevelde-Rougale s’est nourrie d’une recherche pour analyser la langue utilisée par le management. La novlangue managériale. Emprise et résistance, est l’occasion de démontrer comment elle peut parfois gripper les émotions, voire empêcher de les penser et donc d’exprimer son mal-être qui est pourtant bien présent. Entretien.
Socio-anthropologue et chercheuse associée au Laboratoire de changement social et politique (université Paris-Diderot-Paris 7), Agnès Vandevelde-Rougale s’est nourrie d’une recherche pour analyser la langue utilisée par le management. La novlangue managériale. Emprise et résistance, est l’occasion de démontrer comment elle peut parfois gripper les émotions, voire empêcher de les penser et donc d’exprimer son mal-être qui est pourtant bien présent. Entretien.
Propos recueillis par Audrey Minart
Qu’appelez-vous exactement « novlangue managériale » ? Pourquoi ce terme d’Orwell ?
Il s’agit du langage managérial néolibéral, qui a été intériorisé par les individus. Si j’ai choisi le terme de « novlangue », c’est en effet par référence à 1984. Dans ce roman d’Orwell, le « novlangue » est un outil créé par le gouvernement pour manipuler la pensée des gens, et plus précisément pour les empêcher de penser certaines notions, comme la liberté par exemple. J’ai donc choisi cette expression afin de faire comprendre qu’il y a quelque chose dans le management qui empêche de penser. Mais avec l’idée de « langue » incluse dans la novlangue managériale, il y a aussi l’idée d’un outil du management que l’on peut utiliser et réagencer à sa manière, comme on peut le faire avec toute langue.
Quels seraient les termes de cette novlangue qui, selon vous, ne sont pas pensés ?
Gouvernance, transparence, respect, responsabilité… et d’autres. Des termes qui ne sont pas uniquement liés au management néolibéral, mais qu’il s’est réapproprié. L’autonomie par exemple où, dans une entreprise donnée, être autonome c’est agir dans l’intérêt de l’entreprise. Il y a aussi la qualité. Auparavant, elle renvoyait à un « travail bien fait », sur lequel on pouvait passer du temps. Aujourd’hui, elle renvoie davantage à un arbitrage entre trois choses : qualité, coût, délai. Autrement dit, le produit doit avoir l’air bien, le temps passé à le produire ne doit pas être trop important, tout comme l’argent dépensé pour le réaliser. Si l’on passe trop de temps pour produire quelque chose de beau, ou une analyse approfondie par exemple, cela ne va pas être reconnu, dans certains milieux, comme étant un travail de qualité, mais plutôt comme un gaspillage des ressources de l’entreprise. Cela peut poser un problème éthique aux salariés, créer une dissonance cognitive et même un mal-être chez ceux qui ont appris tout au long de leur vie que la forme comme le fond, la qualité du produit fini, sont essentiels.
Vous développez beaucoup justement, dans votre ouvrage, cette impossibilité d’exprimer des émotions. Pourquoi est-ce important ?
Pour le management néolibéral, le sujet idéal est quelqu’un qui est capable de « gérer » ses affects. Il faut pouvoir se contrôler face au client par exemple, être toujours souriant, même s’il est agressif… Il faut pouvoir contrôler sa colère, ne pas montrer sa déception. Et cette exigence a une influence pernicieuse : à force de ne pas exprimer ses émotions, on ne parvient plus à les penser. On empêche aussi les manifestations émotives physiques, les larmes par exemple, qui sont à peine tolérées chez les femmes, et encore moins chez les hommes. C’est un signe de faiblesse. Autre exemple : les manifestations de colère peuvent être tolérées chez un chef à l’égard de ses subordonnés, mais l’employé qui réagit par la colère contre son chef risque quant à lui d’être accusé d’insubordination. Un contrôle s’exerce donc sur les émotions que l’on a le droit ou pas de manifester, en fonction de son genre et de sa place hiérarchique. Et la novlangue managériale renforce cette idée qu’il y a des choses que l’on peut dire, ou faire, et d’autres non. Quand les salariés s’approprient le discours managérial, cela les empêche de penser leurs émotions en rapport avec ce qu’ils vivent au travail, ce qui peut aussi empêcher de penser le travail. Quand on étouffe les émotions, on ne peut plus les questionner. Quand on étouffe les émotions négatives, on a un mal-être, mais on ne peut pas l’exprimer.
Les émotions négatives n’ont-elles pas un rôle protecteur, par ailleurs ?
En effet. Les travaux menés en psychologie sociale montrent qu’elles ont un rôle dans l’adaptation de l’être humain à son environnement, et qu’il est important de les partager. Et cela dépasse le seul monde du travail. Le fait est que les émotions ont un rôle d’alerte. Quand on a peur d’aller au travail, plutôt que de se dire « Non mais c’est n’importe quoi, je vais juste au travail », on peut se poser la question de « Qu’est-ce qui me fait peur ? De quoi j’ai peur ? ». Cela peut permettre de relativiser la peur en la replaçant dans le contexte réel, plutôt que de la laisser sur la scène fantasmatique, mais aussi de prendre conscience qu’il se passe quelque chose, et qu’on peut sans doute agir sur ce quelque chose. Ces alertes émotionnelles ne sortent pas de nulle part. Par exemple, il peut y avoir des manœuvres qui sont faites pour vous écarter, et dans ce cas on peut aller puiser dans ses forces pour se battre et garder son poste, ou bien chercher ailleurs. Plutôt que de simplement étouffer sa peur, et ses émotions plus globalement, et de s’épuiser petit à petit…
Quelles solutions auriez-vous tendance à préconiser pour sortir de cette novlangue, qui paraît assez écrasante ?
Sur le lieu du travail même, il n’est pas toujours évident d’en sortir. D’autant plus que la novlangue managériale nous protège aussi, car elle peut nous permet d’éviter de montrer notre vulnérabilité. On peut donc également s’en servir comme carapace pour avancer et faire entendre une situation, et faire changer les choses dans l’organisation. Par exemple, en cas de situation vécue comme du harcèlement moral, si l’on reste sur le registre de la plainte, de la peur, de la maladie, on risque d’être renvoyé à soi-même, comme si on était à la source des problèmes. Il ne s’agit donc pas forcément de se débarrasser de la novlangue, mais il peut être utile de prendre conscience que ce discours existe pour s’en servir. Après, en sortir, c’est important pour penser autrement ce qu’il se passe. Il serait intéressant par exemple, dans certaines organisations soucieuses de lutter contre la souffrance au travail, d’offrir des espaces pour dire et penser le vécu au travail, avec des tiers, où les salariés peuvent exprimer leurs émotions. Et même si l’organisation ne fait rien, on peut prendre le temps, à l’extérieur, par le dessin, l’écrit, d’exprimer vraiment ce qu’on ressent, par exemple la sensation, pour certains, d’être menacés de mort, même si c’est avant tout une représentation de la scène fantasmatique. Cette extériorisation peut aider à prendre conscience qu’il se passe quelque chose, et à réfléchir dessus. Mais c’est difficile à faire tout seul. Il est important d’avoir une écoute. Directe, par un proche ou un professionnel de l’accompagnement, ou encore en utilisant l’écrit, qui permet un peu de s’adresser à quelqu’un d’autre. Il est aussi important de prendre du temps pour penser, parce qu’il est difficile, sinon impossible, de penser ses émotions dans la précipitation de l’action.