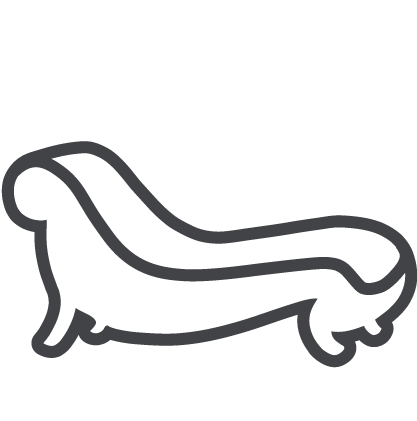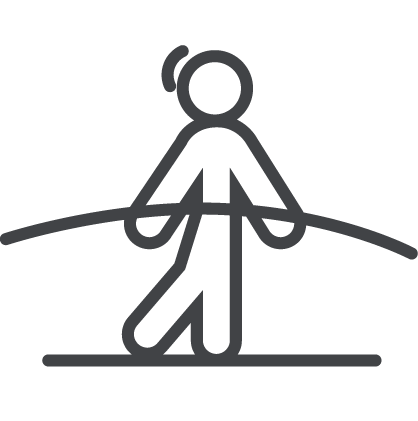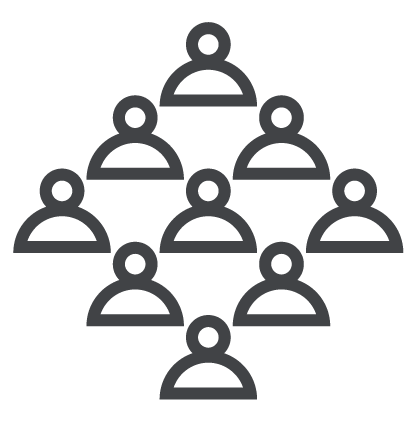Entretien avec Bénédicte Vidaillet
Marie-Françoise Dubois-Sacrispeyre : Bénédicte Vidaillet, vous êtes psychanalyste, professeur des universités à l’université Paris Est Créteil. Vous faites partie du comité de rédaction de la revue Savoirs et clinique et de la Nouvelle revue de psychosociologie qui sont toutes deux publiées aux éditions érès. Vous êtes également coauteure, avec Gilles Arnaud et Pascal Fugier, de Psychanalyse des organisations. Théories, cliniques, interventions (érès, collection « Sociologie clinique », 2018). Ce nouveau livre Pourquoi nous voulons tuer Greta. Nos raisons inconscientes de détruire le monde n’est pas un livre de psychanalyse à proprement parler, même si bien sûr votre réflexion en est imprégnée. Il rejoint vos engagements politiques puisque vous êtes aussi militante écologique. Pourriez-vous nous expliquer la genèse de ce livre ? Qu’est-ce qui vous a motivée pour en entreprendre la rédaction ?
Bénédicte Vidaillet : Je suis engagée depuis plus de vingt ans dans la cause environnementale et il y a longtemps que je m’étonne que, malgré les alertes répétées sur le désastre écologique qui est en train de nous emporter, nous continuions collectivement de l’ignorer. Rien ne change vraiment. Et plus nous recevons d’informations objectivant l’ampleur de ce qui est à l’œuvre – du réchauffement climatique à l’extinction massive des espèces, en passant par le pillage des ressources naturelles, les pollutions en tous genres, la disparition des milieux naturels, etc. –, plus nous voyons que notre société techno-industrielle fait des ravages écologiques, moins nous sommes prêts à y renoncer. Nous voulons continuer à croire à la fable de telle ou telle invention technologique susceptible de nous sauver. Une telle répétition, dans le fait de ne pas tenir compte d’un danger mortel, ne peut qu’intéresser la psychanalyste. Car la répétition, surtout quand elle a partie liée avec la mort, peut s’analyser comme une marque de notre inconscient et s’interroger du côté du symptôme.
J’ai été d’autant plus frappée par ce phénomène qu’avec la gestion de la pandémie, on a vu qu’au contraire, dans des domaines autres que celui de l’environnement et du climat, évoquer un potentiel danger pouvait nous conduire à accepter, et même à demander, des mesures immédiates et radicales.
Dans ce livre, j’ai donc voulu explorer les racines inconscientes de notre obstination à produire ce désastre écologique dont nous sommes pourtant conscients.
MFDS : Nous avons ensemble beaucoup réfléchi à son titre que nous avons souhaité provocateur. Pouvez-vous expliquer ce choix ?
BV : La psychanalyse a une vision de l’être humain qui n’élude pas sa complexité psychique et notamment l’intrication permanente, chez chacun, entre pulsions de vie et pulsions de mort, entre ce qui nous attire vers le lien, l’amour, l’autoconservation, d’un côté, mais aussi, de l’autre, vers la destructivité et le néant. En cela, la psychanalyse continue de déranger. Et là, il s’agit de comprendre pourquoi nous en arrivons à un tel degré de destruction et de violence à l’égard de la nature. Cela me conduit à expliciter nos fantasmes profonds vis-à-vis de celle-ci : la terreur qu’elle nous inspire, du fait de l’autonomie qui caractérise le vivant, terreur qui peut se muer en volonté de la détruire ou de supprimer ses capacités à se reproduire ; ou encore l’idée qu’elle accapare à son profit des ressources inépuisables dont il s’agit de l’en priver, comme le mauvais sein qu’évoquait Melanie Klein. Je m’intéresse aussi à ce phénomène très frappant : nous n’arrêtons pas d’évoquer ces pauvres « générations futures », mais tout ce que nous faisons conduit à les sacrifier. Alors, il faut bien envisager l’hypothèse que, peut-être, nous ne leur voulons pas que du bien. J’ai été médusée par la virulence des attaques de l’élite politique, économique et médiatique contre la jeune militante pour le climat, Greta Thunberg, qui ne faisait pourtant, dans ses interventions, que reprendre quelques chiffres-clés des rapports du giec pour inciter les décideurs à engager des actions plus radicales. C’est assez inoffensif et, pourtant, certains ont même appelé à la tuer ! Cela me semble très révélateur du rapport que nous entretenons réellement avec nos descendants, et de l’impact que cela peut avoir dans nos réactions au désastre écologique. Ne vivons-nous pas ces jeunes comme des rivaux risquant de nous priver de ce que nous détenons – nos modes de vie, nos privilèges, nos petits plaisirs, notre pouvoir –, et de nous tuer symboliquement ? Et dans ce cas, pourquoi nous soucier de leur sort, surtout si cela implique, en plus, de renoncer à tout cela ? Le titre avait donc vocation à nous interpeller sur cet aspect, qui peut sembler tabou et très difficile à admettre.
De manière générale, la psychanalyse permet de poser la question de notre responsabilité dans l’histoire ; nous ne sommes pas que victimes du désastre environnemental, nous y prenons certainement une part active. Qu’est-ce qui peut aussi nous arranger, même inconsciemment, dans ce qui est à l’œuvre ? Ces hypothèses vont bien au-delà de ce que certains psychologues considèrent comme une « éco-anxiété » qui nous paralyserait, ou encore comme du « déni » parce que nous aurions tellement peur de ce qui arrive que nous préfèrerions faire l’autruche. Un des titres envisagés était d’ailleurs « Désir de désastre », pour signifier justement cette implication profonde, même si elle est inconsciente – ou peut-être d’autant plus profonde qu’elle est inconsciente.
MFDS : Vous explorez en vous appuyant sur diverses disciplines, dont la psychanalyse, notre volonté de maitriser et de dominer la nature, notamment parce qu’elle renvoie à des peurs profondes et archaïques, jusqu’à chercher inconsciemment à la détruire. Vous évoquez de nombreuses situations concrètes, pouvez-vous en donner des exemples ?
BV : L’angoisse que provoque en nous la nature peut s’observer à partir de faits presque banals. Avez-vous déjà remarqué l’extrême sérieux du jardinier du dimanche qui enfourche son mini-tracteur pour tondre quelques mètres carrés de pelouse ? Et le rictus satisfait qu’il affiche invariablement à un moment ou à un autre de l’opération ? Les milliers de watts engagés sont à la hauteur de la manière dont il se représente la tâche, fantasmatiquement : une grande bataille contre la nature, avec de vrais moyens pour en venir à bout. Et encore, le répit sera de courte durée : il faut déjà programmer la prochaine tonte ! On trouve d’autres exemples, bien plus spectaculaires, dans la science-fiction dite « horrifique », qui joue sur la peur que peut provoquer en nous l’autonomie du vivant, sa capacité à tirer profit de son milieu et à se développer de manière singulière et imprévisible. C’est le thème central du film culte Alien, le huitième passager, de Ridley Scott, grand succès des box-offices en 1979. Ou, plus récemment, en 2017, du film Life – Origine inconnue. Ici, ce qui est montré et nous fait peur, renvoie à ce que Freud appelle « l’inquiétante étrangeté », cette sorte d’angoisse très particulière associée au fait que ce qui était jusqu’alors perçu comme familier révèle son caractère étrange et effrayant, dévoile son altérité radicale. Ce quelque chose qui vient d’ailleurs reste irréductiblement extérieur au sujet, impossible à assimiler, à approcher, à apprivoiser. Si Freud relie le malaise diffus de l’inquiétante étrangeté à l’angoisse originaire du nourrisson, dépendant pour sa survie psychique comme physique d’un extérieur qui lui échappe entièrement, Lacan en fait un signal qui saisit le sujet confronté à l’inconnu du désir de l’Autre, un désir qui pourrait le mettre à sa merci. C’est ici l’autonomie du vivant qui inquiète, sa capacité de transformation susceptible de nous prendre de court et, imagine-t-on, de nous mettre en danger. Ce sentiment peut être simplement ressenti lors d’une promenade en forêt, lorsque, parfois, l’enchantement à se trouver dans un univers ressourçant glisse insidieusement vers une inquiétude sourde.
MFDS : Au fond, quel objectif poursuivez-vous à travers ce livre ?
BV : Ce qui est sûr, c’est qu’on ne trouvera pas dans ce livre de promesses de « guérison » aux maux qui nous empoisonnent et compromettent notre survie, tant la recherche frénétique de solutions fait partie intégrante du désastre. La « solutionnite » n’est que la manifestation d’une toute-puissance dont je montre combien elle est centrale dans notre culture et indissociable de la production de ce désastre. De plus, elle conduit également à empêcher l’élaboration psychique nécessaire pour réellement prendre la mesure de ce qui est à l’œuvre.
Si mon approche peut sembler dérisoire face à l’immensité des destructions en cours, et à leur irréversibilité, elle rend cependant apparent que l’éventualité de nous engager politiquement dans une autre voie est conditionnée par une transformation psychique profonde. J’ai cherché dans ce livre à nous rendre plus conscients des processus psychiques qui, à notre insu, déterminent notre participation au désastre.
MFDS : Pouvez-vous dire quelques mots de cette transformation ?
BV : Il s’agirait par exemple de pouvoir accepter notre petitesse, notre vulnérabilité, notre finitude et notre état d’être parlant et donc manquant, comme ce qui fait notre condition humaine, pour assumer ce que cela implique, plutôt que de vouloir à tout prix en faire fi et engager tous nos efforts culturels à prétendre la dépasser.
Fondamentalement, cette transformation implique de pouvoir assumer que l’impression sensible que nous éprouvons en face de ce qui n’est pas d’origine humaine est justement ce qui nous donne le sentiment de la nature ; de pouvoir reconnaître l’autonomie et l’alien qui caractérisent le vivant sans que cela conduise à vouloir en prendre la maîtrise, le mater, l’éradiquer, attenter à sa fertilité, voire s’en passer par l’artificialisation. Tous processus qui ont pour fonction d’éliminer son étrangeté et son caractère Autre. Or, il s’agirait plutôt de partir de là, d’accepter cette vie Autre, sans craindre qu’elle nous envahisse, nous anéantisse. De la laisser être et de se laisser affecter par sa présence, sans chercher à la faire sienne ni à la détruire. Nous serions alors beaucoup plus disposés à respecter ses logiques d’existence, à accompagner son développement et à nous donner les moyens de lutter contre tout ce qui porte atteinte à son autonomie.