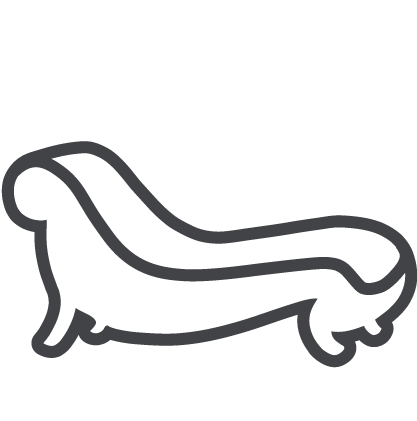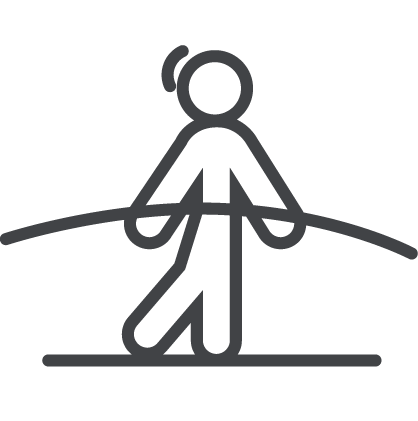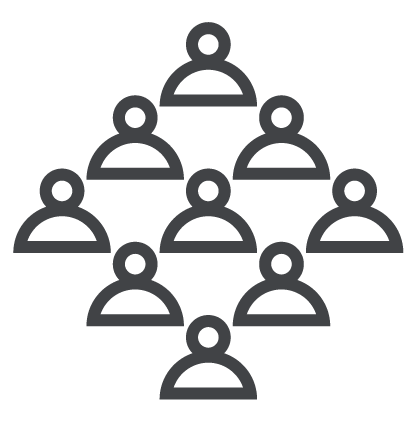Pascale Hassoun (par Audrey Minart)

Dans Un dragon sur le divan (érès, 2017), Pascale Hassoun raconte ses voyages en Chine au début des années 2000, invitée par un Chinois, Huo Datong (psychanalyste et professeur de l’université de Sichuan), qui souhaitait y introduire la psychanalyse. Là-bas, elle a réalisé un travail proche de la supervision, un « deuxième regard », auprès d’étudiants apprenant à pratiquer la psychanalyse. Une expérience qui l’a notamment amenée à se confronter à une culture où les rapports parentaux ne s’organisent pas sur le même mode qu’en Occident, et où la parole n’a pas le même statut.
Propos recueillis par Audrey Minart.
Pour quelles raisons avez-vous décidé de vous embarquer dans cette expérience ?
C’était au départ tout à fait circonstanciel. J’avais du temps, et des amis proches étaient en contact avec Huo Datong… Quand je suis arrivée, nous nous sommes rendus compte que nous nous étions déjà croisés à Paris, quand il y était étudiant en thèse. Il m’a ensuite proposé de venir régulièrement pour écouter ses propres étudiants, eux-mêmes en analyse. Ils avaient besoin d’une sorte de supervision, c’est-à-dire de parler de leurs premières « cures » avec leurs patients, mais aussi d’eux-mêmes, avec quelqu’un qui avait de l’expérience. Il s’agissait d’interventions ponctuelles, et c’était difficile parce qu’il est impossible de tout résoudre en une fois. À savoir que Huo Datong proposait également, en parallèle, un enseignement, ayant comme expérience sa propre analyse et surtout les textes lacaniens, sur lesquels il a fait porter sa thèse. Je pense qu’il m’a proposé de venir parce que j’avais de l’expérience clinique en institution, et dans le privé, et qu’il a vite compris que j’essayais de la transmettre avec les mots les plus simples possibles.
Comment avez-vous surmonté l’obstacle de la langue, essentielle en psychanalyse ?
C’était en effet une difficulté majeure. Le chinois est assez difficile, c’est une langue très riche et complexe. J’ai essayé de l’apprendre ici à Paris, mais je n’ai jamais réussi à le parler. Il y a des tons que je n’entends pas. Pour sa part, Huo Datong exigeait de ses étudiants qu’ils apprennent le français, pour pouvoir le lire. Il avait même pour projet de les envoyer en France afin qu’ils réalisent une thèse sur Lacan, pour revenir ensuite en Chine et occuper des postes à l’université… Quoi qu’il en soit, je me suis retrouvée en face de jeunes Chinois qui avaient suivi des cours de français, qui préparaient leur rencontre avec moi, qui avaient apporté avec eux leur petit dictionnaire sur Internet… Mais qui ne comprenaient pas forcément tout ce que je leur disais parce qu’ils n’avaient pas encore suffisamment de connaissances en français. C’était donc parfois assez laborieux. L’autre solution a été de trouver une bonne traductrice. C’est d’ailleurs, au fond, assez révélateur de l’analyse, qui vise en quelque sorte à traduire ce que le patient est en train de dire. De lui renvoyer quelque chose. Il y a un passage de langue, y compris dans une analyse réalisée dans la même langue. Par ailleurs, il y a une spécificité de chaque pensée par rapport à chaque langue. Donc pour entrer davantage dans la pensée chinoise, il aurait fallu que j’en connaisse la langue. Cela m’aurait été très utile.
Avez-vous rencontré d’autres obstacles, plus culturels ?
Oui. J’ai mis un certain temps pour parvenir à me dégager du sujet occidental, celui à qui on apprend très tôt qu’il est un sujet autonome, qu’il doit se construire, que le meilleur service qu’il puisse rendre à ses parents c’est d’être responsable de sa propre vie, et qu’il aura à partir à un certain âge. Il m’a été difficile de quitter cette référence, et admettre qu’il y avait d’autres types de sujets, et en particulier le sujet chinois à qui on ne demande pas cette forme d’autonomie. Au contraire, on lui demande d’être porteur d’un système basé sur le principe de la piété filiale : être un bon fils, celui qui reconnaît ses ancêtres et qui a un enfant. Ce que l’on attend de lui c’est d’être un des membres d’une chaîne. C’est un système hiérarchique, très difficile à admettre pour moi.
Alors qu’en France, on a plutôt tendance à encourager l’opposition aux parents ?
Elle peut aussi se faire en Chine, mais le fils ne doit pas faire perdre la face au père. C’est assez subtil. La psychanalyse offre un espace pour dire ses difficultés. Pas forcément pour agir contre les parents, mais pour pouvoir exprimer toute l’ambivalence ressentie vis-à-vis d’eux. Ce qui m’amène à la troisième difficulté : le statut de la parole en Chine. J’ai remarqué que l’on demande au sujet chinois de contenir ses sentiments, de ne pas les exprimer pour ne pas blesser l’autre. Il n’a qu’à supporter. Il rencontre donc de nombreuses difficultés à parler dans l’espace de l’analyse. C’est soit pour se plaindre, parce qu’il est malheureux et que c’est le seul espace pour le dire, ou alors pour demander des conseils à la psychanalyste que je suis, venue de Paris, et donc considérée comme étant plus haut dans la hiérarchie. Il faut en tenir compte. Ils sont aussi habitués à ne pas dire les choses directement. C’est la parole allusive. On entre là dans un ensemble culturel très vaste. En Occident, nous avons un rapport à quelque chose de transcendant, à un Dieu, un grand Autre, fondateur du monde. Les Chinois ne l’ont pas. Pour eux il y a le ciel, la terre, et l’être humain doit travailler aux rapports harmonieux entre l’un et l’autre. Il y est donc difficile d’exprimer les ambivalences… Il y a aussi chez eux une peur du conflit. Il est donc difficile de leur expliquer que le conflit peut avoir une fonction dynamique, qu’il existe aussi un conflit entre le conscient et l’inconscient, qu’il est à l’intérieur d’eux, qu’il est fondateur, qu’il ne doit pas être évité, mais exploré.
Cette expérience interroge-t-elle selon vous la psychanalyse ? Et a-t-elle eu un impact sur votre pratique ?
Oui elle interroge la psychanalyse qui, née dans le monde occidental, véhicule des notions qu’elle affirme comme étant universelles… mais qui sont en fait très locales. Dans la société chinoise, la fonction du père se situe davantage sur un mode vertical dans une référence aux ancêtres, alors qu’en Occident, le père est considéré dans la triangulation œdipienne. Cela nous oblige donc à regarder nos mythes fondateurs, et à revisiter nos concepts, notamment le phallus. Sur le complexe d’Œdipe, je pense personnellement qu’il y a bien un attachement érotique d’un enfant au parent de sexe opposé, une rivalité œdipienne, mais les Chinois n’aiment pas du tout cette idée. Surtout parce que, pour eux, le père n’est pas la référence phallique. Ce serait plutôt la mère. Cela nous oblige aussi, et la société actuelle nous y invite également, à bien faire la différence entre la forme et le contenu. Avant, la disposition du cabinet de l’analyste, où le patient est allongé sur le divan, était sacro-sainte. Moins aujourd’hui. Je vois également un problème dans l’idée que l’on peut réaliser un travail thérapeutique et psychanalytique sur Internet, quand il n’y a pas la présence des corps, un phénomène répandu en Chine. Mais c’est peut-être une question de générations. Autre point auquel je tenais, et j’y tiens encore plus : l’expression de la vie affective. J’ai vu beaucoup de souffrance, mais sans que celle-ci ne trouve de possibilité de se dire, c’est un aspect que j’évoque longuement dans le livre. Plus globalement, cette expérience a confirmé beaucoup de choses dans ma pratique, et notamment l’importance de l’accueil. Quand quelqu’un parle il s'agit d’offrir un espace pour penser ce qui arrive, le recevoir. Le but de la psychanalyse est d’aider à penser sa vie, et de parvenir à être dans un dialogue avec soi-même. Les Chinois rencontrent quelques difficultés pour cela, et sont donc beaucoup dans le passage à l’acte.