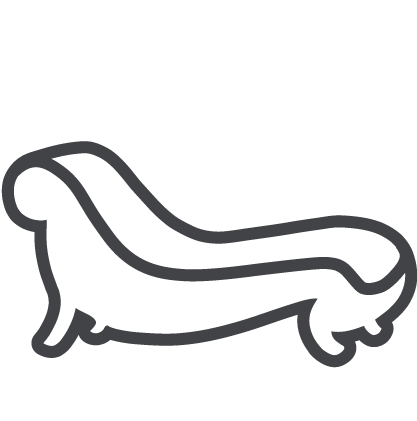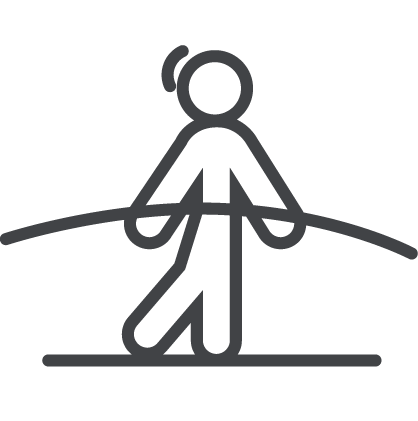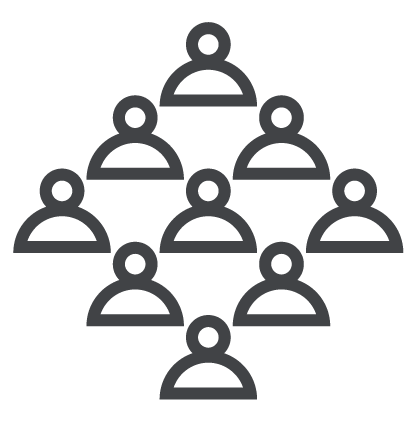Mieux comprendre et aider à vivre les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer
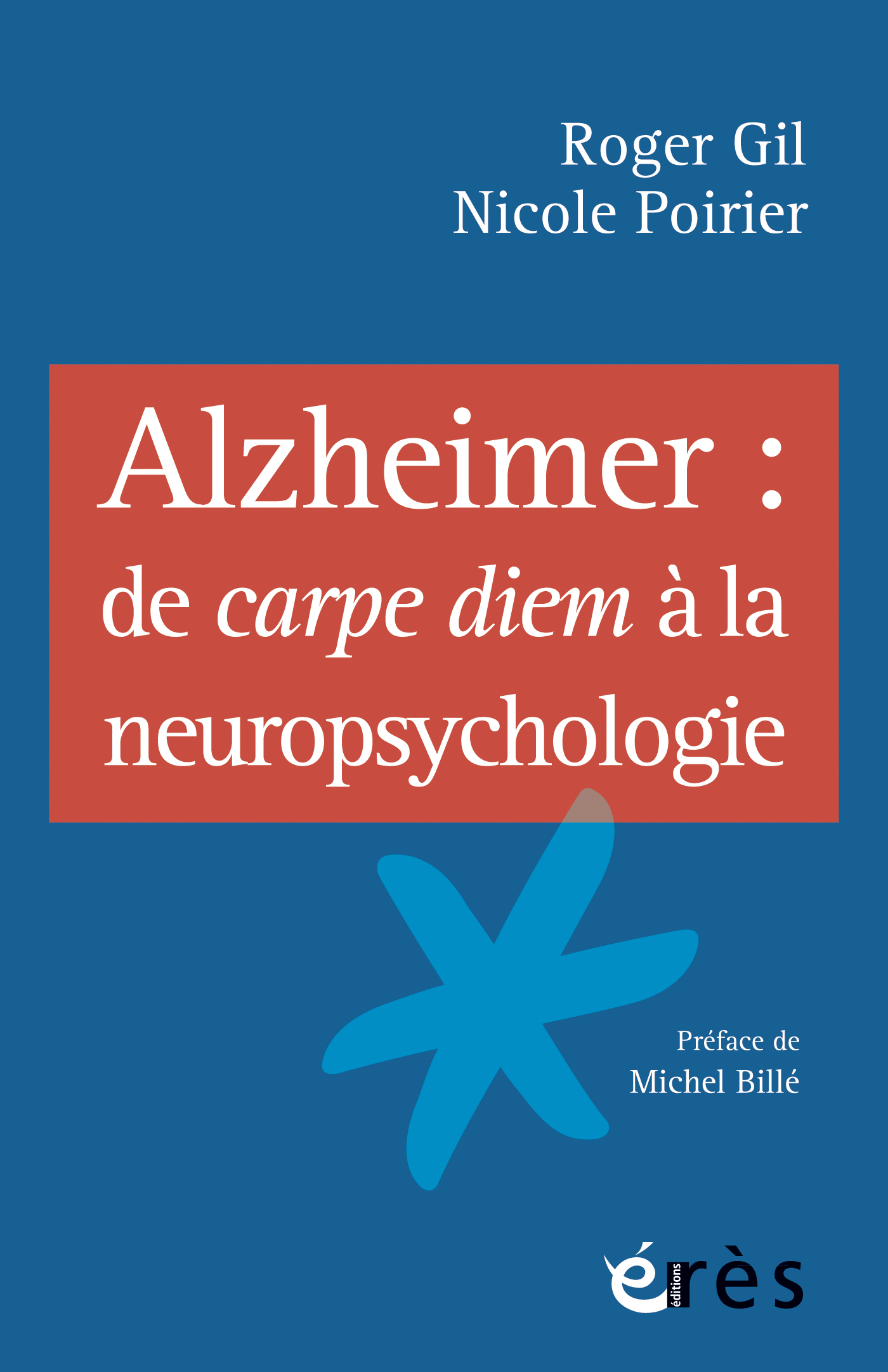 Cet échange entre Nicole Poirier, fondatrice d’un lieu d’accueil
Cet échange entre Nicole Poirier, fondatrice d’un lieu d’accueil
de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer
au Québec, et le neuropsychiatre Roger Gil, membre de France Alzheimer, démontre à quel point
il peut être enrichissant de faire dialoguer les deux démarches.
Sa lecture invite notamment le lecteur à dépasser la seule vision médicale
pour lui préférer une approche humaniste, moins axée sur les capacités perdues
que sur celles qui restent. C’est également l’occasion de s’interroger sur l’adéquation
des lieux d’accueil et sur la formation du personnel,
généralement lacunaire.
Propos recueillis par Audrey Minart
Comment est né le projet Carpe Diem ?
Nicole Poirier : En 1985, alors que je n’avais aucune expérience dans ce domaine, j’ai transformé la maison familiale en lieu d’accueil pour personnes âgées. Je me souviens, à l’époque, avoir demandé à une résidente si elle souhaitait m’aider à cuisiner ou à faire le ménage, mais elle ne semblait pas comprendre mes demandes. J’en ai déduit qu’elle ne savait pas faire. Sauf qu’un jour elle m’a vue faire la vaisselle et a attrapé un torchon. J’ai alors compris que l’on pouvait communiquer autrement qu’avec des mots, en faisant des gestes, et me suis pleinement intéressée à cette maladie. Après quelques recherches et démarches, j’ai créé un autre lieu en m’appuyant sur cette expérience.
Roger Gil, qu’est-ce qui vous a attiré dans ce projet ?
Roger Gil : L’approche humaniste défendue par Nicole Poirier, qui a le mérite de ne pas être encombrée par notre historique de formation de médecins. Quand je l’ai rencontrée, j’ai pensé que ses observations pouvaient être validées sur un plan neurologique. Pour reprendre l’exemple de la vaisselle : cela renvoie à l’empathie, aux neurones miroirs… Sur le même principe : il peut être plus judicieux de s’asseoir à côté de la personne plutôt que de lui demander de le faire en restant debout à côté d’elle. L’approche humaniste permet ainsi de découvrir des chemins d’accompagnement du malade.
Vous écrivez : « Suivre de consultation en consultation une personne qui a la maladie d’Alzheimer, c’est observer d’abord la progression des déficits. » L’approche humaniste peut donc permettre d’aller au-delà ?
Roger Gil : En effet. Même si cette vision médicale générale est utile : nous suivons les pertes, et nous sommes satisfaits si nous avons l’impression que nous les ralentissons. Nous comptons en soustractions, en débits. L’approche humaniste renverse un peu les choses en se demandant ce qu’il reste, et en se préoccupant avant tout de savoir comment aider ces personnes à vivre, à être relativement heureuses. Ce qui est perdu est davantage considéré comme accessoire. Nous avons certes besoin d’une approche scientifique, par exemple avec les tests, mais il ne faut pas transformer un diagnostic en un accompagnement. Ainsi, ce regard croisé permet à la prise en charge d’atteindre une autre dimension. Si l’on veut vivre dans une société inclusive, il faut cesser d’être obsédé par l’idée de guérir.
Nicole Poirier : De mon côté, cette rencontre m’a permis de constater que nos pratiques pouvaient être validées par les observations scientifiques. Toutes ces connaissances nous ont aussi aidés à mieux comprendre les différentes formes de mémoire, et les mécanismes d’apprentissage.
Vous regrettez le terme de « troubles du comportement ». Tous les comportements, aussi incohérents qu’ils puissent nous apparaître parfois, ont donc bien un sens ?
Nicole Poirier : Effectivement, nous pouvons ne pas comprendre ce qu’il se passe, mais cela ne signifie pas que ça n’a pas de sens. Une résidente m’a un jour demandé si elle avait faim. Cela peut paraître incohérent, sauf que l’on sait qu’ils n’ont parfois presque plus de mots pour s’exprimer… Peut-être demande-t-elle en fait si elle va manger, quand, etc. ? Si on considère que ce qu’elle dit n’a pas de sens, on balaye tout de la main. Elle peut faire une hypoglycémie, ou se mettre en colère et finir sous neuroleptiques… Alors que tout ce qu’elle voulait probablement, c’est manger.
Roger Gil : D’un point de vue scientifique pur, on parle de « troubles du comportement » parce que le comportement n’est pas celui que l’on attendait. Mais si l’on ramène tout à la « maladie », on a fini de réfléchir. Et que fait-on alors ? Soit rien, soit on met sous médication, pour calmer. Il y a une deuxième manière de faire : voir la maladie comme une sorte de miroir déformant de ce que la personne était. Néanmoins, ce qu’on appelle un trouble du comportement exprime quelque chose. Si un patient s’agite et veut sortir pour aller voir sa mère, pourtant décédée depuis dix ans, on peut en effet qualifier cela de trouble du comportement. Mais si on sait qu’il peut prendre du passé pour du présent, on a alors une explication et donc un moyen de pouvoir le réintégrer, certes peut-être dans ses illusions… Mais non, nous n’avons pas à lui dire à chaque fois que sa mère est décédée.
À vous lire, les lieux d’accueil actuels ne sont pas adaptés ?
Nicole Poirier : Ces personnes arrivent du jour au lendemain dans des endroits inconnus et doivent vivre avec des gens qu’elles n’ont jamais rencontrés. Leurs difficultés de mémoire à court terme, d’adaptation et de compréhension ne sont pas suffisamment prises en compte. Et donc, malgré toute la bonne volonté du personnel, elles finissent par se demander ce qu’elles font là, et souhaitent partir retrouver les leurs. C’est une réaction normale vu les circonstances, sauf qu’elle est interprétée comme un trouble du comportement qui serait à corriger. Une approche plus en amont serait donc nécessaire, afin de créer la confiance. Je pense aussi que l’on manque de connaissances et que le personnel n’est pas assez soutenu. Il n’a pas assez d’outils à sa disposition pour analyser les situations difficiles, et finit par s’épuiser faute de réponses. Cela mène à des réponses qui visent à contrôler la personne, plutôt qu’à la comprendre. Il faudrait également s’organiser pour qu’elle puisse sortir régulièrement et continuer à avoir accès au monde qui l’entoure. Une meilleure adaptation devrait permettre de vivre davantage le quotidien avec la personne et, par exemple, manger avec elle, plutôt que de rester debout à côté. Ce n’est pas cohérent.
Vous critiquez le tutoiement, par le personnel, des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, même quand elles le demandent. Pourquoi ?
Roger Gil : Il y a là quelque chose d’insupportable. L’affection réelle n’est pas dans cette familiarité excessive qui, au final, déconsidère la personne malade.
Nicole Poirier : Nous savons que la personne risque un jour de souffrir de prosopagnosie, et donc qu’elle ne reconnaîtra plus les visages. Résultat : si elle demande à être tutoyée au début, elle risque, plus tard, de ne pas me reconnaître. Comment faire alors pour revenir au vouvoiement ? Cela peut aussi conduire à de la familiarité et à des conduites qui ne favorisent pas la bientraitance. Par ailleurs, quand la maladie progresse, que l’on ne parvient plus à accomplir des gestes du quotidien comme baisser son pantalon, ou même à remonter ses lunettes sur son nez, le vouvoiement reprend toute sa place. À Carpe Diem, nous nous vouvoyons, même au sein de l’équipe, afin d’éviter que cette demande soit formulée. Les familles sont étonnées au début, mais adhèrent rapidement quand elles comprennent le sens. Quoi qu’il en soit, il nous appartient de sensibiliser et former le personnel sur les conséquences et les pièges du tutoiement. Nous devons également les former sur des attitudes à éviter, comme celle qui consiste à tenter de rappeler à la personne les événements passés à court terme alors qu’elle les oublie systématiquement, etc.
Que pensez-vous de l’efficacité des traitements médicamenteux prescrits aux patients atteints de la maladie d’Alzheimer ?
Roger Gil : Je pense que dérembourser les anticholinestérasiques et la mémantine, comme c’est le cas depuis le 1er août en France, est une erreur. Même si globalement leur activité est faible, ils peuvent améliorer l’état de certaines personnes. En outre, ils peuvent agir favorablement sur les hallucinations chez certains malades... On s’éloigne donc, sur des arguments utilitaristes, de la médecine pour la personne, tout en empêchant l’égalité d’accès puisque les prix ne seront plus maîtrisés. Et ça c’est inacceptable.
Quid des psychotropes ?
Nicole Poirier : Ils peuvent être utiles pour certaines personnes. Cela dit, on y a recours trop vite, sans analyse ni remise en question. Au Québec, le gouvernement a obligé les établissements à mettre en place un programme pour diminuer le recours aux neuroleptiques pour les personnes âgées, particulièrement celles qui vivent avec la maladie d’Alzheimer. Mais il faut aussi donner des outils aux équipes, les aider à comprendre des réactions agressives, qui peuvent en fait exprimer de l’inconfort, de la douleur et de l’incompréhension. Les traiter avec des médicaments ne permet pas d’agir sur la cause ou de trouver le besoin derrière la réaction. Par exemple, une personne qui se lève la nuit peut avoir besoin d’aller aux WC mais être incapable d’y aller seule ou de l’exprimer. Elle peut avoir faim, soif ou être inquiète. Si l’intervenant n’a pas la formation pour décoder le besoin, il peut être porté à traduire cela comme un trouble du sommeil, ou de la « déambulation nocturne ». Et si elle entre dans une chambre qui n’est pas la sienne, comme un trouble perturbateur. Alors qu’elle ne fait que chercher une solution à son problème : aller aux toilettes, manger, être rassurée. Et si l’organisation n’est pas adaptée (pas de nourriture disponible, pas de personnel), il sera tentant d’avoir recours à un calmant ou à un somnifère… qui ont des effets sur la cognition, l’autonomie. Cela peut également provoquer de l’incontinence, avec des effets sur l’humeur : la personne peut devenir dépressive si elle porte une protection alors qu’elle serait capable d’utiliser les toilettes avec un peu d’aide et d’organisation. Ce petit exemple montre qu’il serait possible de réduire la spirale : calmants, neuroleptiques, antidépresseurs.
Roger Gil : Effectivement. Les neuroleptiques n'étaient pas initialement prévus pour traiter les troubles du comportement, mais pour tenter de réduire les délires et hallucinations. Mais ensuite on a constaté qu'ils étaient "agressivolytiques". On a même parlé de "camisole chimique", d'où leur utilisation dans les états d'agitation alors que, comme vous le dites, la majorité ne sont pas d'ordre psychotique. En plus des effets secondaires, ils induisent des lenteurs motrices parkinsoniennes ou des mouvements anormaux, des états d'apathie et de ralentissement. Même dans les états d'agitation psychotique, c'est souvent l'angoisse qui entraîne l'agitation et qui appelle d'abord l'écoute et la réassurance. Un neuroleptique ne peut se prescrire que de manière exceptionnelle, après avoir fait un diagnostic précis sur le plan psychologique et neuropsychiatrique, et avec d'infinies précautions.
À propos
Retrouvez chaque mois le texte de l'un de nos auteurs sur des sujets d'actualités