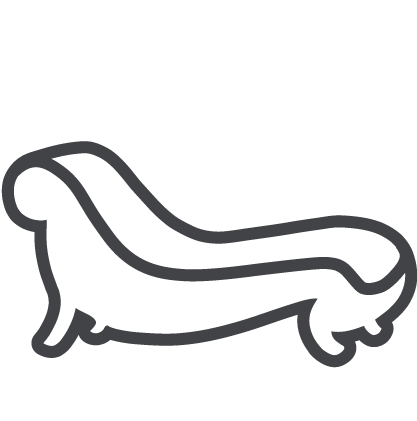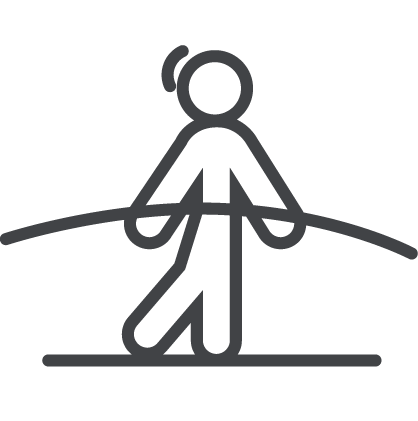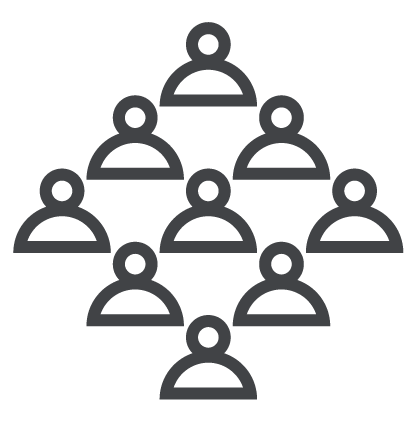Jean-Louis Laville, vous êtes professeur du cnam, titulaire de la Chaire « Économie Solidaire », chercheur au Lise (CNAM - CNRS) et au Collège d’études mondiales (fmsh). Depuis 2005, vous dirigez aux éditions érès la collection « Sociologie économique » qui analyse les reconfigurations à l’œuvre des rapports entre le social et l’économique. À ce titre, vous vous intéressez aux pratiques émergentes qui relèvent de l’économie sociale et solidaire et aux théoriciens comme Karl Polanyi qui ont pensé l’économie comme une construction institutionnelle répondant à des besoins humains à travers des interactions sociales et environnementales et non uniquement aux mécanismes du marché.
Maïté Juan, vous êtes docteure en sociologie, chercheure associée au programme de recherche « Démocratie et économie plurielles » du Collège d’études mondiales (fmsh) et membre associée du Lise. Vos travaux se situent à la croisée de la démocratie participative, des communs et de l’économie solidaire. Vous avez dirigé ensemble – avec Joan Subirats, professeur de sciences politiques à l’université autonome de Barcelone (igop), co-fondateur du mouvement politique Barcelona en Comu, et aujourd’hui en charge des politiques culturelles à la mairie de Barcelone – un ouvrage collectif qui me paraît venir à point nommé Du social business à l’économie solidaire. Critique de l’innovation sociale. En effet, l’innovation sociale fait aujourd’hui l’unanimité. Elle est mise à toutes les sauces pour légitimer des pratiques qui ne servent pas les mêmes objectifs et ne sont pas toutes vertueuses.
Comment est apparu le social business ? Dans quels domaines est-il le plus actif ?
Maïté Juan et Jean-Louis Laville : Les préconisations néolibérales, largement adoptées par les gouvernants, recommandent d’endiguer la baisse tendancielle de la croissance, principalement attribuée à un excès d’intervention de l’État. Les résistances émanant des mobilisations altermondialistes dans les années 1990 amènent cependant les gouvernements à opter pour des mécanismes correcteurs au sein même du néolibéralisme : l’innovation sociale constitue l’un d’entre eux. Il s’agit de créer une dynamique de moralisation du capitalisme et d’intégrer la question sociale dans ses registres de justification.
Le recours explicite au social business vient compenser les maux engendrés par le capitalisme. Ce capitalisme social se caractérise par son professionnalisme gestionnaire. Il procède par mimétisme avec les entreprises privées. Le social business popularisé par Mohammad Yunus (2008) repose, en effet, sur le récit du sauvetage des pauvres par leur retour sur le marché à travers des formes de capitalisme à but social s’appuyant sur plusieurs outils comme : la venture philantropy, une philanthropie beaucoup plus soucieuse de la rentabilité de ses investissements, les contrats à impact social facilitant les investissements privés dans des projets sociaux dont le financement relevait auparavant de la puissance publique, et le modèle du « bas de la pyramide » (Prahalad, 2010) qui met au point des techniques de marketing adaptées au marché des pauvres.
Dans le même mouvement, on peut identifier un autre vecteur puissant de normalisation marchande de l’innovation sociale : la montée en force de l’accompagnement des associations par tout un ensemble de cabinets de conseils et think tanks qui défendent les partenariats bénéfiques entre les associations et le secteur privé lucratif comme stratégie de modernisation des initiatives citoyennes.
MFDS : En quoi ce modèle est-il présenté comme emblématique du nouveau monde contrairement aux associations qui relèveraient du monde ancien ?
M.J & JLL : Dans un contexte de restriction des financements publics et de généralisation des appels d’offres, les consultants poussent les associations à développer des coopérations avec le secteur privé lucratif.
Les cabinets de conseil entendent ainsi construire des modèles standardisés et compatibles avec le capitalisme, en impulsant un « changement d’échelle de l’innovation sociale », et en proposant des solutions réplicables sur plusieurs territoires.
Pour les associations, ce référentiel modernisateur comporte des biais majeurs. D’une part, les modèles de management d’entreprise préconisés constituent une forme de disqualification des associations, renvoyant ces dernières à l’amateurisme et à des modes de gestion artisanale. D’autre part, ce discours technocratique martèle la nécessité d’alliances entre associations et entreprises pour renforcer les financements privés, sans distinguer les entreprises relevant du capitalisme international financiarisé et les entreprises relevant d’une économie marchande territorialisée, composée des petites et moyennes structures qui gardent un ancrage local. Enfin, cette montée en force d’une « idéologie partenariale » véhicule une vision consensuelle et pacifiée où les rapports entre associations et secteur privé à but lucratif seraient régis par de simples relations de complémentarités stratégiques : la dimension de désaccord, de conflit et de débat collectif entre associations et entreprises autour des finalités, significations et méthodologies de la coopération n’est pas appréhendée. En somme, sous prétexte de nouvelles synergies entre secteur privé lucratif et associations, cette approche modernisatrice et partenariale masque les rapports de force.
MFDS : Comment définiriez-vous les initiatives solidaires qui peuvent être occultées par le social business ?
M.J & JLL : Le paradoxe est que le social business promu par les élites n’existe guère sur le terrain, ses réalisations sont très peu nombreuses. Par contre, de multiples initiatives citoyennes existent souvent dans l’ignorance des décideurs. Elles se définissent d’abord comme des actions collectives à la fois sociopolitiques et socioéconomiques, et non seulement comme des entreprises sociales : elles s’inscrivent dans une visée de démocratisation de la société et de transformation politique par le recours à un modèle économique différent. Elles interrogent les fondements des inégalités sociales et les finalités de l’échange économique qui devrait grâce à la solidarité démocratique, bénéficier à la collectivité dans son ensemble. La production de biens et de services est régie non par la rentabilité ou le profit mais par des objectifs humains et sociaux, tels que l’insertion socioprofessionnelle de populations en situation de précarité, la dynamisation socioculturelle d’un quartier, le développement territorial de zones rurales désertées ou de zones urbaines marquées par un désinvestissement des services publics, la lutte contre des discriminations (de genre, de race, de classe), l’agriculture paysanne de proximité, la protection de l’environnement, l’entretien du patrimoine local, l’inclusion financière, etc.
C’est parce que ces initiatives s’attaquent à des problèmes sociaux structurels affectant les populations dans leur quotidien qu’elles reposent sur la mobilisation citoyenne, l’engagement bénévole ou la participation des habitants-usagers à l’élaboration des activités. Elles se fondent également sur des dynamiques de coopération et de mutualisation territoriale avec les autres entités associatives, publiques ou privées. Ces multiples logiques économiques, qui ne se réduisent pas aux ressources marchandes, intègrent pleinement les ressources de la réciprocité, impulsent une démocratisation de l’économie dans les tissus sociaux locaux, au service du bien-être et de la subsistance des populations. Ainsi ces initiatives solidaires s’inscrivent dans une dynamique de politisation ordinaire : elles tendent à se construire comme des espaces de prise de parole, des « espaces publics de proximité » à partir de l’expérience vécue, où les habitants usagers, les bénévoles, les professionnels participent à la co-construction de l’offre et de la demande. La création du service obéit à des logiques de participation et de délibération collective qui garantissent son utilité sociale, son adéquation aux besoins du territoire et de ses habitants. C’est pourquoi leurs modèles de gestion ne peuvent pas et ne doivent pas être assimilés au modèle de la gestion d’entreprise, valorisant le changement d’échelle, l’optimisation managériale des organisations, la mesure d’impact social, la reproductibilité des modèles par l’identification de bonnes pratiques standardisables, l’efficacité marchande, le mécénat, etc. La richesse et la force de ces initiatives, c’est leur nature transversale et multifonctionnelle. Elles ne peuvent être réduites à un secteur ou un type d’activité cloisonné : elles sont à la fois politiques, économiques, culturelles, éducatives, sociales. Pour sortir des injonctions à l’adaptation entrepreneuriale et se démarquer des accusations d’amateurisme et d’archaïsme dont elles font l’objet, ces initiatives doivent impulser une réflexion commune sur la diversité des formes organisationnelles, afin de cheminer vers une gestion démocratique qui préserve leur projet sociopolitique.
MFDS : Vous mettez l’accent sur les démarches de coproduction de savoirs entre experts et société civile, dont les recherches participatives sont un levier. En quoi peuvent-elles participer de la reconnaissance de l’innovation sociale et apporter des solutions pour transformer la société ? Comment ces dynamiques de coproduction des savoirs peuvent-elles se retrouver à l’échelle de l’action publique ?
M.J & JLL : Les recherches participatives sont, en effet, un cas emblématique de démarches de coproduction de connaissances entre savoirs experts et savoirs citoyens. Elles questionnent à la fois les formes de gouvernement technocratique qui excluent les contributions citoyennes au débat public et le monopole des chercheurs dans la production des savoirs. À ce titre, elles peuvent sous-tendre les processus d’innovation sociale, à diverses échelles, mais cela dépend fortement des modalités de division sociale du travail entre les participants : certaines démarches de coopération bousculent la hiérarchie des savoirs et les asymétries de pouvoirs, d’autres s’inscrivent dans une perspective de perfectionnement des pratiques professionnelles d’intervention sociale, tandis que d’autres encore cantonnent les citoyens au statut de « petite main » dans la collecte de données.
Dans la sphère des recherches participatives émancipatrices, on peut ranger les démarches qui valorisent, dans le débat public et dans la sphère académique, les savoirs invisibilisés et discrédités de populations marginalisées, telles celle d’atd Quart monde avec les personnes en situation de pauvreté, l’approche citoyenne Capdroits, mobilisant des personnes en situation de handicap mental et psychique, qui entendent toutes deux influencer les politiques publiques en matière de lutte contre les exclusions. On peut aussi mentionner certaines démarches qui s’inscrivent dans une double perspective de défense des savoirs et savoir-faire paysans issus de l’agro-écologie et de contestation de l’accaparement des semences par le système agroalimentaire, tel que le réseau Semences paysannes, ou encore l’Incubateur universitaire Paroles d’ExcluES au Québec qui a permis de créer un certain nombre de services adaptés aux besoins des habitants (logements communautaires, centre pour la petite enfance, etc.). Dans ces recherches, les citoyens disposent d’un espace pour s’exprimer, partager leurs expériences de vie, déconstruire les stéréotypes et coproduire des savoirs autonomes collectifs ancrés dans leurs pratiques, qui peuvent ensuite être confrontés aux savoirs experts.
Ces mêmes dynamiques peuvent se déployer à l’échelle institutionnelle, dans des espaces de négociation et de travail collectif mêlant acteurs associatifs et institutionnels. Comme l’analyse Joan Subirats dans ses deux contributions, à Barcelone, la municipalité de Barcelona en Comù s’est ainsi engagée dans la co-construction de diverses politiques publiques avec les réseaux associatifs autour des communs urbains, de l’économie sociale et solidaire, de la souveraineté alimentaire et de la transition écologique notamment, en reconnaissant l’expertise citoyenne de ces réseaux. Cela se concrétise, par exemple, par la construction collective d’indicateurs communautaires qui aident les acteurs associatifs à évaluer leurs propres pratiques, par l’élaboration de nouveaux dispositifs de participation et de représentation pour les associations, etc. Ce qui est intéressant dans le cas barcelonais, c’est que cette interdépendance entre expertise citoyenne et expertise institutionnelle se construit selon une dynamique de coopération conflictuelle, d’articulation entre l’autonomie citoyenne et le changement institutionnel.
Finalement, l’innovation sociale transformatrice renvoie aux nécessaires complémentarités entre savoirs citoyens et savoirs experts, qu’ils soient politiques ou scientifiques. Les dynamiques de coproduction des savoirs apparaissent aujourd’hui centrales tant pour légitimer, dans le débat public, des savoirs disqualifiés et minorisés que pour nourrir l’action publique à partir des pratiques de terrain. L’expertise associative a aujourd’hui tout son rôle à jouer dans l’approfondissement de la démocratie participative : il s’agit de favoriser des formes d’arrimage au cadre institutionnel qui favorise les coopérations conflictuelles entre décideurs politiques et acteurs associatifs et qui repose sur l’émergence de savoirs hybrides, issus du croisement d’une pluralité d’expertises.
À propos
Retrouvez chaque mois le texte de l'un de nos auteurs sur des sujets d'actualités